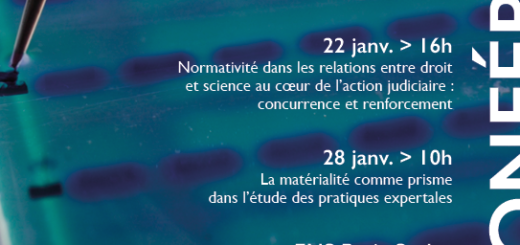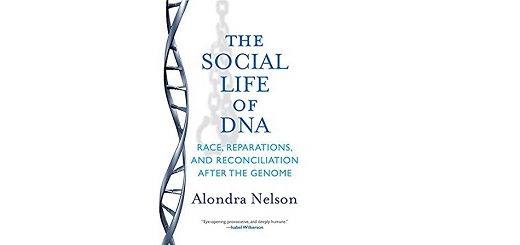Ecole d’été « Approches éthiques et juridiques de la vérité en science » 6-7 juillet 2023
La Chaire UNESCO Éthique, Science et Société portée par l’Université de Toulouse organise comme chaque année son école d’été, en présentiel et en visioconférence, qui porte cette année 2023 sur le thème : « Approches éthiques et...