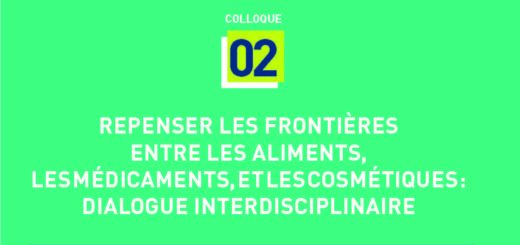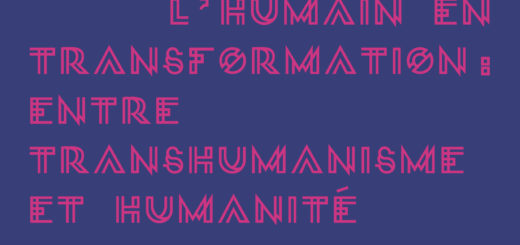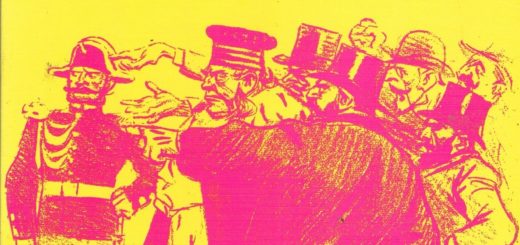Les inscriptions aux journées des ateliers NoST sont ouvertes !
Les 24 et 25 juin prochains se tiendront les journées annuelles des ateliers du GDR NoST. Cet événement sera hébergé au Centre culturel irlandais. Programme Consulter le programme des journées. Inscription L’entrée est ouverte...